
Johnny O’Neal
Johnny ’s back in Town
Depuis son retour à New York en 2011, le pianiste et chanteur Johnny O’Neal est un des pianistes les plus demandés de la ville. Il ne compte pas moins de six résidences en clubs, et dès qu’il joue au Smalls, au Mezzrow, au Smoke, au Fat Cat, au Ginny’s Supper Club, au Minton’s, chacun de ses concerts est un événement. Entre les gigs et les tournées en Europe qui reprennent, il était invité par Wynton Marsalis, le 10 juin dernier, à accompagner le Jazz at Lincoln Center Orchestra à l’occasion du centenaire de Billy Strayhorn. 2016 était l’année de la renaissance et de la reconnaissance.
Né le 10 octobre 1956 à Detroit, dans le Michigan, c’est en voyant son père jouer du piano chez des voisins qu’il se décida à apprendre en jouer en autodidacte. Le gospel fut son premier amour. Comme il nous le raconte dans l’interview, il se met au jazz au début des années soixante-dix à Saint Louis. A son retour à Detroit, il joue aux côtés de Kenny Burrell. Epris de la musique de Bud Powell, il se nourrit aussi de celle d’Art Tatum, Erroll Garner et Oscar Peterson.
En 1981, il s’installe à New York, joue avec Clark Terry la semaine même de son arrivée, puis rejoint Milt Jackson, Art Blakey et les Messengers (1982-1983). En 1985, il joue en solo en première partie d’Oscar Peterson au Carnegie Hall. Toujours grâce à Peterson, il incarne Tatum dans le film Ray (2004).
De la fin des années 1980 à 2011, il vit à Atlanta, Saint Louis, Detroit, devient aussi programmateur de club. En 1998, il met en suspens sa carrière, suite à la découverte de sa séropositivité, et retourne vivre à Detroit.
C’est donc un homme affaibli physiquement qui est revenu à New York. Son jeu, quant à lui, était intact. Très rapidement, il a conquis un public jeune, épaté de sa virtuosité, de l’émotion qui se dégage de ses sets et de la diversité de son répertoire. Ces jeunes sont bien ceux à qui il s’adresse. Son trio se compose toujours de musiciens d’une vingtaine d’années. Ce jazz de culture, de savoir-faire, de partage, il met toute son énergie à le leur transmettre. Après Luke Sellick (b) et Charles Goold (dm), il joue aujourd’hui avec Ben Rubens (b) et Itay Morchi (dm). Propos recueillis par Mathieu Perez
Photos de Pascal Kober
© Jazz Hot n°679, printemps 2017

Jazz Hot: Le chant a-t-il toujours fait partie de votre vie?
Johnny O’Neal: C’était dans ma famille. Mon père chantait très bien. Mais, enfant, je n’osais pas vraiment chanter. Des années plus tard, c’est Joe Williams qui m’a encouragé. Il m’a entendu un soir à Kansas City. Je jouais dans un hôtel. Je chantais alors une seule chanson dans le set. Joe m’a demandé pourquoi je n’en chantais pas plus. Il m’a dit que j’étais un chanteur naturel, et que j’avais ce qu’il fallait pour être un bon chanteur. Il m’a dit: «Souviens-toi de ceci: si un instrumentiste de jazz pouvait chanter, il le ferait». Depuis qu’il me l’a dit, le chant et le piano sont inséparables. Pour certains, chanter compromet la musique. Mais je n’y crois pas du tout! Je pense plutôt que ça amplifie la musique parce qu’avec les paroles, vous comprenez ce qu’une chanson signifie. Ça vous rend plus sensible encore. Ça donne aussi au musicien plus de précision, plus de poids, et ça l’aide à développer davantage son propre son.
Chanter, cela vous a-t-il rendu meilleur pianiste?
Oui. Mais vous savez, j’ai toujours aimé accompagner les chanteurs. Ça me vient de mon père. Quand j’étais enfant, il mettait un disque de Sarah Vaughan ou d’Anita O’Day, et il me faisait écouter ce qu’elle chantait, et il parlait du jeu du pianiste. Il me disait aussi qu’un pianiste qui sait accompagner un chanteur aura toujours du travail. Et il avait raison. Beaucoup de pianistes ne savent pas comment s’y prendre avec les chanteurs. Ce n’est pas parce qu’ils ne les aiment pas. Les chanteurs peuvent être terribles! Vous pensez connaître une chanson, mais un chanteur ne le chantera pas dans la clé que vous connaissez! Certains pianistes ne peuvent pas changer de clé comme ça. C’est pour ça que les chanteurs m’aiment bien. Si je connais une chanson, je peux la jouer dans toutes les clés. Je n’ai jamais autant joué avec des chanteurs qu’à New York. J’ai eu la chance d’accompagner des chanteurs comme Carmen McRae ou Sarah Vaughan. Quand Johnny Hartman venait à Detroit, il demandait que ce soit moi qui l’accompagne. Quel compliment!
Vous ne chantiez pas à l’époque où vous jouiez du gospel…
Non, ma sœur chantait du gospel. C’est elle qui m’a incité à jouer du gospel. Elle a un an de moins que moi. Le gospel était mon premier amour. J’aime toujours ça. Je parle souvent de mes racines gospel dans mes concerts, mais c’est très difficile de jouer autre chose après. C’est pareil avec le blues. Et c’est pareil pour tout le monde! Qui que vous soyez, c’est dur! Si je pense jouer un gospel ou un blues, je le garde pour la fin du set.
Qui avez-vous accompagné en tant que pianiste gospel?
Au début des années 1970, j’étais le pianiste de gospel le plus connu de Detroit. J’ai eu la chance de jouer avec de formidables chanteurs comme James Cleveland ou Mattie Moss Clark. J’ai aussi beaucoup enregistré avec des chœurs de gospel. Je n’aurais jamais imaginé devenir musicien de jazz un jour!
Comment s’est faite la transition du gospel au jazz?
Ça s’est passé en 1975. Je vivais à Birmingham, en Alabama. Je devais avoir 19-20 ans. Après le lycée, j’ai déménagé là-bas. J’avais rencontré un chanteur de Saint Louis, et je jouais avec lui. Puis il est reparti à Saint Louis. Un jour, il m’appelle parce qu’il avait un gig dans un hôtel. C’était trois semaines. Il voulait que je l’accompagne.
Où se passait le gig?
A Saint Louis. Il a payé mon billet de bus. Je me souviens, je suis arrivé un samedi. Je l’attendais devant la gare. Et puis quelqu’un est venu me parler. Il m’a demandé si je cherchais un taxi. Il se trouve qu’il était guitariste de jazz, et qu’il travaillait comme chauffeur de taxi en complément. Il allait à un club et m’a proposé que je l’accompagne. Il me déposerait après à mon hôtel. On est allé dans un club qui s’appelait «Mr. Connor’s Jazz House». Le leader du groupe était le batteur Kenny Gooch. A cette époque-là, je connaissais quelques standards mais je n’étais pas un grand improvisateur. Je lui ai tout de même demandé si je pouvais jouer. Vous savez, Detroit a cette réputation d’avoir d’excellents pianistes. Alors Kenny a tenté sa chance, et je me suis mis au piano. Je me suis fait copieusement hué! C’était une de ces humiliations! J’ai pleuré comme un bébé! Mais je n’ai pas quitté le club. Par bonheur, il s’avérait que c’était le dernier soir du pianiste. Il repartait chez son père travailler avec lui dans un magasin de musique. Et il m’a demandé de rejoindre le groupe. Je lui ai dit que je n’étais pas assez bon… Mais il avait dû entendre quelque chose.
Et ce chanteur que vous deviez rencontrer au début de votre histoire?
Je ne l’ai jamais vu!
Combien de temps êtes-vous resté à Saint Louis?
Toute l’année 1976. Je jouais six soirs par semaine, matinée le samedi. J’étais payé 100 dollars par semaine.
Avez-vous eu l’occasion de jouer avec des musiciens fameux?
Cette même année à Saint Louis, Miles Davis est venue un soir au club. Il a joué des titres comme «If I Were a Bell» ou «Spirits of Trane». Mais un client a tout gâché. Il criait du fond du club: «Joue "’Round Midnight”! Joue "’Round Midnight”!» Miles lui a répondu: «Va falloir me payer pour ça, connard!»
Comment était le groupe de Kenny Gooch?
C’étaient des musiciens de jazz très costauds. Ils adoraient Max Roach, Bud Powell. Ils jouaient des morceaux bebop très durs. Kenny me mettait souvent dans l’embarras, et me donnait des solos. «T’as le premier solo, Johnny!» Et si je ne connaissais pas le titre, il me prenait par le col et me disait: «Si tu déconnes encore une fois, je te casse la gueule!» A l’époque, les musicos étaient durs! Aujourd’hui, vous ne pouvez même pas faire une critique constructive à des jeunes. A l’époque, il fallait être loyal et jouer collectif. J’ai donc dû me concentrer et apprendre à accompagner ces souffleurs.
Comment vous entendiez-vous avec les autres musiciens?
J’étais le plus jeune de la bande. Les musicos étaient des junkies, de vrais junkies! Moi, je ne prenais pas de drogue. On jouait le répertoire. C’était formidable! J’ai beaucoup appris. C’est eux qui m’ont fait écouter les disques de Bud Powell, Hank Jones, Gene Harris, Art Tatum et, bien sûr, de ceux de mon héros, Oscar Peterson.
Quand j’étais petit, mon père travaillait à l’usine. Nous étions huit enfants. Il avait arrêté de jouer de la musique en professionnel. Il n’y avait pas de piano à la maison; c’est venu bien plus tard. Un jour, je l’ai entendu jouer du piano à la fête d’un voisin; ça m’a vraiment épaté! Je voulais en jouer comme lui. Un jour, il est rentré à la maison avec un piano.
Vous êtes autodidacte…
On pense souvent que j’ai une éducation classique, mais pas du tout! Oui, je suis autodidacte. J’aime beaucoup le classique. Rubinstein et Horowitz sont mes pianistes classiques préférés. C’est bien la technique; c’est ce qui rend vos idées musicales écoutables pour les autres et ce qui vous permet de les articuler. Mais juste jouer vite, ce n’est pas intéressant.
Votre parcours a été marqué par la rencontre de Barry Harris. Quand l’avez-vous rencontré pour la première fois?
La première fois que j’ai rencontré Barry, je devais avoir 14 ans. Je suis allé le voir chez lui à Detroit. Je jouais encore du gospel. Il était épaté. La deuxième fois que je l’ai vu, il jouait avec Blue Mitchell et Harold Land. Il se souvenait du gosse qui jouait du gospel! J’ai joué pour lui, et il m’a dit combien j’avais fait de progrès. Il m’a dit que si je venais à New York, que je l’appelle, qu’il aurait une belle surprise pour moi.
Quand êtes-vous parti pour New York?
C’était en novembre 1979. J’ai conduit de Detroit à New York. Dix heures de route. Au fait, c’est là qu’on apprend beaucoup de musique. En écoutant la radio.

Avez-vous retrouvé Barry Harris?
Sitôt arrivé, je l’ai appelé. Il m’avait donné rendez-vous vers Central Park. Il me répétait qu’il avait une belle surprise pour moi, mais il ne disait jamais ce que c’était! On s’est enfin retrouvé, et on est parti en voiture dans le New Jersey chez la baronne Pannonica. Il devait y avoir 13 ou 14 chats chez elle. Ça sentait très fort. Barry m’a amené voir Monk dans sa chambre. Il m’a présenté à lui. Monk s’est levé de son lit…
Il était au lit?
Oui, il était allongé dans son lit. On est allé au salon. L’appartement avait une vue incroyable sur l’Hudson River.
Etiez-vous familier avec Monk à l’époque?
Je savais qui était Monk, mais j’étais si jeune… On a traîné ensemble toute la journée. Il a joué pour moi. C’était un vrai gentleman. C’était comme un père. J’ai joué pour lui. Il m’a dit que j’avais un toucher magique au piano, et que je devais continuer de jouer. Le rapport entre nous était très fort. Nous partageons aussi le même jour de naissance. Je serais toujours reconnaissant envers Barry pour m’avoir présenté à Monk.
Revenons en arrière. Qu’avez-vous fait après 1976, cette année passée à Saint Louis?
Après ça, je suis reparti à Detroit, et j’ai commencé à explorer la scène jazz. Tout le monde était choqué que je joue du jazz!
Comment décririez-vous la scène jazz de Detroit?
Dans les années 1970, le disco venait d’arriver, et le jazz commençait à se détériorer. Beaucoup de clubs et d’hôtels ont arrêté d’avoir de la musique live. J’ai beaucoup joué dans des hôtels. Le disco a changé la scène jazz. Mais il restait quelques clubs comme Baker’s. C’est le club de jazz le plus ancien. Il a été ouvert en 1932. J’ai enregistré plusieurs albums là-bas. Donc, il n’y avait plus de clubs. Il fallait aller à New York pour ça.
Quel a été votre premier grand gig à Detroit?
Jouer avec Kenny Burrell au Baker’s. Mon trio l’accompagnait. Puis, j’ai joué avec lui tous les Thanksgiving pendant quatre ou cinq ans. Quand j’étais petit, j’allais au Baker’s avec mon père. Je n’aurais jamais pensé y jouer un jour! Puis, j’ai joué avec Sonny Stitt. Le patron m’aimait bien. Quand il embauchait certains des grands noms du jazz, il me demandait de les accompagner. C’est comme ça que j’ai joué avec Johnny Hartman, Nat Adderley, Harry Sweets et Eddie Lockjaw Davis, et certains grands maîtres de cette génération. Ils avaient tous leur propre répertoire. On me demande souvent d’où je tiens mon répertoire. Simplement en jouant avec beaucoup de musiciens différents.
Chantiez-vous à l’époque?
Je ne chantais pas beaucoup à l’époque, mais Kenny Burrell m’a fait chanter plusieurs titres comme «Until the Real Thing Comes Along» ou «Skylark». J’étais encore très timide! (Rires) Pour être un chanteur, il faut mettre sa timidité de côté et devenir un conteur avec les paroles d’une chanson. Maintenant, le chant et le piano vont de pair. Je n’ai jamais pensé que ce serait le cas.
La rencontre avec le batteur Benny Carew a été importante pour vous. Pourquoi?
Benny Carew est le premier leader avec qui j’ai vraiment appris à jouer avec un trio. C’est un excellent batteur et leader. Benny Carew avait dans les 70 ans. C’était un de ces vieux pros qui avait de la discipline. Il m’a donné beaucoup de conseils. Parfois, il m’autorisait presque à être le leader du groupe parce qu’il aimait ma façon d’organiser un set. Il pensait que j’avais une façon très naturelle de donner forme à un set. Je lui suis très
reconnaissant. Il a toujours cru en moi. C’est pour ça qu’aujourd’hui je
me sens obligé de jouer avec des jeunes. Ce n’est pas que je veux pas
jouer avec mes contemporains, mais les jeunes tirent le meilleur de moi
et c’est l’avenir cette musique.
Que jouiez-vous avec lui?
Il aimait les standards: Jerome Kern, Irving Berlin, Duke Ellington, etc. On jouait ce répertoire dans des hôtels. C’est ce que le public voulait entendre. Kenny était un bon chanteur aussi. J’ai beaucoup appris en l’accompagnant comme chanteur.
Et après ça?
Après ça, j’ai commencé à jouer avec mon groupe. On jouait dans des hôtels à travers les Etats-Unis. En 1979, je faisais un gig à Gary, dans l’Indiana, et j’avais vu que Ray Brown passait au Jazz Showcase de Chicago. Gary n’est qu’à 30 miles de Chicago. Alors un dimanche, jour de repos, j’ai conduit là-bas. J’avais toujours voulu rencontrer Ray Brown!
Avec qui Ray Brown jouait-il?
C’était Ray Brown Trio avec Ernestine Anderson.
Comment la rencontre s’est-elle passée?
Je me suis présenté à Ray. Je n’arrive pas à croire que j’ai eu le culot de lui dire que je jouais du jazz. Je lui ai demandé de faire le bœuf avec lui. Il m’a regardé comme s’il se disait: «Il se prend pour qui ce gosse?» Il m’a répondu qu’au club, on ne faisait pas le bœuf. C’était la règle.
Qu’avez-vous fait?
J’ai attendu la fin du concert. Ray emballait sa contrebasse. Il était dans sa loge. Je me suis mis au piano. Là, Ray est sorti de sa loge, m’a écouté jouer et m’a dit: «Ah! Je vois qu’on a un jeune Oscar Peterson.» Et il a ajouté: «Ça te dirait d’enregistrer un disque?» Il avait deux autres jeunes musiciens qu’il voulait produire, John Clayton et Jeff Hamilton. Puis, il m’a fait venir en Californie. Mais le courant n’est pas passé entre les jeunes musiciens. On était de jeunes lions, et on s’est rentrés dedans. (Rires) John Clayton voulait tout contrôler. J’étais découragé. J’ai dit à Ray que je voulais enregistrer avec lui. C’est comme ça que j’ai fait mon premier disque.
Pourquoi ce disque est-il sorti des années plus tard?
Ce disque n’est pas sorti avant 1983! Carl Jefferson, qui était producteur à Concord, l’a sorti quand j’ai rejoint Art Blakey.
Quel souvenir gardez-vous de l’enregistrement de votre disque?
C’était une double session. Ray enregistrait le même jour avec Jimmy Rowles. Ray était encore en pleine forme. C’était un musicien très solide. Après ça, il m’a mis en relation avec Milt Jackson et Dizzy Gillespie.
Pour ce disque, vous aviez composé le titre «Joan Gospel Blues».
Oui, j’ai touché des droits d’auteurs pendant longtemps grâce à ça!
Comment a évolué votre style de jeu dans les années soixante-dix?
J’étais un joueur de bebop, mais j’ai dû changer parce qu’aucun hôtel n’était prêt à payer pour m’entendre jouer ça. Le bebop, c’est ma fondation. Mais je ne trouvais pas de gig, et les chanteurs ne veulent pas être accompagné par ça. J’ai donc baissé d’un cran et joué plus mélodique. Je me suis alors tourné du côté du style d’Oscar Peterson, Hank Jones, Erroll Garner. J’ai pu trouver des gigs comme ça. Mon père me demandait toujours comment j’allais traiter une chanson. On traite une chanson comme on traite une femme. Avant d’ajouter n’importe quel arrangement, il faut apprendre la mélodie et la jouer bien. C’est ce que le public veut entendre. Et puis, si vous jouez du bebop pendant trop longtemps, c’est comme une drogue, vous devenez accro’ et vous ne pouvez plus en sortir.
Dans ce style de piano, qui sont vos héros?
Art Tatum, Teddy Wilson, Nat King Cole, Hank Jones, Erroll Garner, George Shearing. On est souvent surpris quand je dis Shearing, mais il a exercé une grande influence sur moi. Tous ces pianistes ont un toucher magique. J’aime aussi Herbie Hancock, Wynton Kelly. Je suis curieux d’écouter tous les pianistes.

Pourquoi vous sentez-vous si proche de Clark Terry?
Nous avons le même genre de personnalité sur scène. On raconte des histoires et tout ça. On est des entertainers. Certains musiciens sont tellement à fond dans la musique qu’ils pensent que c’est facile d’être un entertainer. Et bien, non! Ça ne se passe pas comme ça. Avoir une relation avec le public, c’est important. Certains musiciens jouent parfois avec tellement de sérieux que le public n’est pas touché. Moi, mon énergie, je la tiens du public. Quand je vais en club pour jouer, c’est un événement pour moi. La musique parle d’elle-même.
Avez-vous joué ensemble?
J’avais joué avec Clark la semaine de Noël au E.J.’s. Je lui ai dit que j’allais m’installer à New York en mars. En 1980, le premier jour de mon arrivée là-bas, c’était un mardi après-midi. J’ai acheté le «Village Voice» pour voir qui jouait, et j’ai vu qu’on annonçait Clark Terry au Blue Note. J’ai appelé Clark, et je lui ai demandé avec quels autres musiciens il jouait. Il m’a dit: «Toi!» Il se trouve que son pianiste avait eu un accident et que Clark cherchait quelqu’un pour le remplacer. Le premier jour de mon arrivée à New York, je jouais avec Clark Terry!
Combien de sets jouiez-vous?
Ce devait être deux sets.
C’est bien cette même semaine que vous avez rencontré Art Blakey?
Il est venu ce samedi-là. A la fin du premier set, quelqu’un s’est approché de moi par derrière. C’était Blakey. Il partait en tournée en Europe la semaine suivante, pendant trois semaines, et voulait que je sois son pianiste.
Qui était dans son groupe?
Le groupe devait avoir deux semaines. Il y avait Terence Blanchard, Donald Harrison, Bill Pierce, Charles Fambrough.
Quel était votre rapport avec la musique de Art Blakey?
Je connaissais sa musique bien sûr, mais je n’avais jamais rencontré Blakey. Et je n’aurais jamais imaginé jouer avec lui! Ce qui était valorisant, c’est qu’il vous faisait travailler la composition. Tout le monde devait écrire. C’était obligatoire. Mais j’étais très gêné parce que je suis incapable d’écrire des partitions. Je compose à l’oreille. Ça rendait Terence Blanchard dingue! Mais Blakey lui disait: «Ne cherche pas d’embrouilles avec lui. Le gosse est un naturel!»
Combien de titres avez-vous composé?
J’ai dû composer trois ou quatre titres. Blakey adorait les pianistes. Il me faisait toujours jouer de longs solos.
Combien de temps duraient-ils?
Toujours 20 minutes. Parfois 30. J’étais le musicien traditionnel dans le groupe. Art me respectait pour ça. C’est lui qui m’a donné un peu plus de notoriété à l’époque.
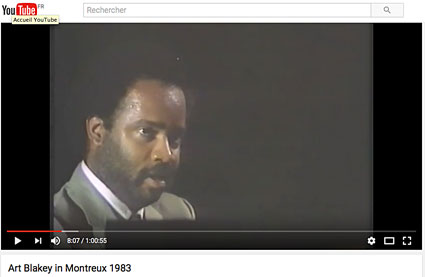 
Vous sentiez-vous à l’aise dans de ce groupe?
J’étais un peu nerveux parce que je ne jouais pas vraiment dans ce style. Harmoniquement parlant, c’était nouveau pour moi. Il fallait prendre ça très au sérieux. La tradition, je maîtrisais, enfin du mieux que je pouvais à l’époque, mais jouer avec Blakey, c’était un autre monde pour moi.
Quels étaient vos liens avec les autres musiciens?
On était tous très proches. On avait le même âge. De temps en temps, Blakey aimait bien créer un peu de tension entre nous.
Quel souvenir gardez-vous de Blakey le leader?
Art ne faisait jamais vraiment le leader. Il avait toujours des jeunes.
Répétiez-vous beaucoup?
On répétait dans un studio à Harlem pendant deux, trois heures. Durant le concert, les partitions étaient interdites. Pour lui, on ne joue pas de jazz avec une partition sous les yeux. Il fallait tout mémoriser.
Gardez-vous un souvenir d’Art Blakey et des Messengers en particulier?
On parlait de gospel tout à l’heure. Une fois, on jouait au Superdome, à la Nouvelle-Orléans, devant 20 000 personnes. Ce jour-là, deux groupes étaient prévus, un groupe de gospel de Philadelphie et nous. Je n’étais pas le directeur musical mais j’ai conseillé à Blakey de jouer en premier car c’est impossible de jouer après un chœur gospel.
Que s’est-il passé?
Le chœur a joué en premier et a fait un carton! Quand on est arrivé, la moitié des gens était partie!
Combien de temps êtes-vous resté avec les Messengers?
A peu près deux ans.
Vous tourniez beaucoup?
Tout le temps. On est allé en Europe cinq ou six fois. On est allé au Japon, en Afrique, on allé partout. Au Japon, Blakey était une superstar! C’était comme Michael Jackson. Dès qu’on descendait de l’avion, on lui déroulait le tapis rouge. On lui donnait des fleurs. Lors des concerts, on jouait devant 30 000 personnes.
Avant Blakey, vous avez joué avec Milt Jackson.
Oui, pendant deux ans. Le premier gig que j’ai fait avec Bags, j’étais si nerveux! La première chose qu’il m’a demandé, c’est si je ne jouais pas ces conneries de musique out! On a joué, il a bien aimé ce que j’avais fait. On a été très proche. On a joué avec Ray Brown, Billy Higgins, Sam Jones, Bob Cranshaw, Mickey Roker.
Qu’avez-vous appris de lui?
Il m’a appris le swing. Il me racontait qu’à l’époque des concerts Jazz at the Philharmonics, organisés par Norman Granz, il y avait Oscar Peterson, l’orchestre de Basie, Ella Fitzgerald. Et Nat King Cole passait en dernier. Quand il arrivait, il balayait tous les autres. Juste avec le temps, son charisme, sa classe, son savoir-faire de chanteur, il balayait tous les autres! (Rires) C’est chez lui qu’Oscar Peterson a puisé son style. C’était une extension de Nat King Cole.
Bradley’s était un club important pour vous.
J’ai joué au Bradley’s. Tous les grands pianistes y jouaient. Le patron m’aimait beaucoup. Il me donnait deux semaines!
Avec quel bassiste jouiez-vous?
Ray Drummond.
C’est vous qui avez lancé la jam session du Blue Note. Comment cela s’est-il passé?
Sal était le patron du Blue Note. Il me demandait de lui donner un coup de main avec la programmation. Un soir, il avait pris Oscar Peterson, mais Oscar ne voulait jouer qu’un set. Sal m’a demandé de jouer un set en plus, mais Oscar a refusé. C’est là que j’ai compris les histoires de politique. Sal m’a demandé alors si je voulais m’occuper de la jam session.
Avec quels musiciens jouiez-vous?
J’avais des musiciens comme Marvin Smitty Smith, Lonnie Plaxico. J’ai dû faire ça pendant un an parce que j’étais toujours en tournée. Ted Curson a pris la suite.
Quels étaient les horaires?
C’était de 1h30 à 3h30 du matin.
Dans les années quatre-vingt, vous avez joué à Montreux avec Dizzy Gillespie, Milt Jackson, J.J. Johnson, James Moody, Philly Jo Jones, Ray Brown.
C’était un hommage à Charlie Parker. Hank Jones avait raté son avion! Il se trouve que j’étais à Montreux. Je me souviens du soundcheck. Ray Brown et Philly Jo Jones n’arrêtaient pas de s’engueuler. Dizzy est arrivé. C’est lui qui a ramené le calme. (Rires) Quand j’y pense, je suis vraiment reconnaissant d’avoir joué avec tant de formidables musiciens. Quand je joue avec des jeunes, ils jouent avec eux aussi. Ils jouent avec tous ceux avec qui j’ai joué.
Vous avez aussi dirigé un club de jazz. Pouvez-vous nous en dire plus?
De 1991 à 1994, je me suis occupé d’un club à Atlanta qui s’appelait «Just Jazz».
Qui avez-vous programmé?
Tout le monde est venu. Cassandra Wilson, Monty Alexander, Count Basie Band, George Duke, etc. J’aimais bien faire ça et j’étais devenu un bon programmateur.
Les groupes jouaient combien de soirs?
En général, deux, trois soirs. J’avais une relation difficile avec le proprio’ du bail. Il était plus intéressé par courir après les femmes que de ses affaires. Il ne payait pas le loyer, etc.
Qu’avez-vous fait après cette expérience?
Après Atlanta, je suis parti à Saint Louis en 1996 puis à Detroit.
Jouiez-vous localement une fois de retour à Detroit?
Pas beaucoup. Je partais en tournée deux semaines et je revenais. Puis, en 1998, j’ai été diagnostiqué avec le VIH. Je jouais à San Francisco un soir, après Shirley Horn. A la fin du premier set, une amie a appelé les secours. J’avais plus de 40°C de fièvre. Je suis tombé dans le coma. On a appelé ma mère. Elle est venue à l’hôpital. Elle a prié pour moi. C’est pour ça que je suis reparti vivre chez elle. J’avais besoin de soins.
Vous aviez un rapport très fort avec votre mère.
Je n’étais pas une célébrité pour ma mère. J’étais son fils. Elle était directive. Elle adorait être une mère. Et je l’ai amenée partout! On a dû faire cinq croisières jazz ensemble. On était allé à Hawaii. Elle venait à mes concerts. Elle m’a entendu jouer avec beaucoup de musiciens différents. Et, même si elle n’était pas musicienne, elle pouvait dire à la fin du premier set, si j’aimais les musiciens. On ne peut pas duper sa mère! Et elle avait toujours raison! Dans les croisières, elle était traitée comme une reine parce que c’était ma mère. Les fans étaient très gentils avec elle. Elle est morte le jour de la fête des mères en 2011. Après ça, mon fils qui vit à New York m’a conseillé de venir m’installer là-bas.
Qu’attendiez-vous de New York?
Je ne savais pas à quoi m’attendre. Je n’aurais jamais pensé revenir à New York. Ma mère et moi avons vécu ensemble les dix dernières années de sa vie.
Comment avez-vous été embauché par Spike Wilner au Smalls?
Je suis allé au Smalls; j’ai joué, Spike m’a embauché immédiatement. Même chose au Smoke; j’ai fait le bœuf avec Mike LeDonne, le club m’a embauché. Aujourd’hui, ça fait cinq ans que je suis de retour et, à chaque fois que je joue, il y a du monde. C’est incroyable!
Au Smalls, vos horaires ont changé. Quelle est la différence?
Les premiers mois, je jouais très tard. Puis j’ai demandé à Spike de jouer en prime time. Quand il a changé les horaires, il a vu la différence tout de suite! Et plus tard, j’étais le premier musicien à jouer au Mezzrow, le soir de son ouverture.
Il y a eu du monde tout de suite?
Tout de suite.
Votre public est jeune. Pourquoi d’après vous?
Oui, il y a beaucoup de jeunes. Quand vous voyez un musicien jouer live, vous voyez son émotion, sa vulnérabilité. Quand vous chantez une chanson, même certains titres méconnus que j’aime bien déterrer, vous avez besoin de vous identifier aux paroles. Autrement, vous ne la vivez pas. J’ai aussi un fan club à Atlanta. Ils doivent être 18. Ils se réunissent tous les dimanches soirs, et ils me regardent jouer en streaming sur le site web du Smalls.
Aujourd’hui, votre trio se compose de Luke Sellick et Charles Goold. Qu’appréciez-vous chez eux?
Ils sont très intuitifs. Ils sont bien formés musicalement. Ils ont soif de jouer. Je leur fais apprendre la musique comme moi je l’ai apprise.
Depuis combien de temps vous accompagnent-ils?
Charles joue avec moi depuis quatre ans. Luke, deux. Avant lui, il y avait Paul Sikivie. Avant Charles, Sharif Zaben, Lawrence Leathers. L’avenir est aux jeunes.
Depuis quand aimez-vous jouer solo?
Depuis 10, 12 ans.
Le concert que vous avez donné en solo au Carnegie Hall en 1985 est très important. Comment s’est déroulée la soirée?
La soirée était produite par George Wein. Il voulait que je joue en première partie d’Oscar Peterson. J’étais en forme à l’époque. Dix minutes avant le concert, j’étais en nage. Mes genoux tremblaient. Un ami m’a donné une goutte de brandy pour me détendre. Je n’avais jamais bu un verre d’alcool; je ne fumais pas; je ne prenais pas de drogue; j’étais clean. C’est peut-être pour ça que j'ai mis tant de choses ensemble, parce que j'étais très concentré. Quand je suis arrivé sur scène, j’étais très crispé. Je me suis installé au piano. J’ai pris quelques grandes respirations et bam! Dès le premier morceau, j’ai senti le courant passer avec le public. Après le concert, je suis allé fêter ça au Carnegie Tavern avec Ellis Marsalis, Kevin Eubanks, Donald Harrison. C’est là que j’ai bu mon premier verre.
Qu’est-ce que cette soirée a changé pour vous?
Le lendemain, la critique du New York Times est sortie. Elle était positive, mais critiquait mon choix de jouer une chanson de Kenny Rogers. Pour eux, c’était une faute de goût. Mais, à l’époque, cette chanson était très populaire. C’est même cette chanson qui a le plus touché le public ce soir-là.
Etiez-vous proche d’Oscar Peterson à cette époque?
Non, pas à cette époque. On se connaissait mais on s’est rapproché des années plus tard. C’est Oscar qui m’a recommandé pour jouer dans le film Ray. Deux-trois ans avant sa mort, il est venu me voir jouer à Toronto. Il était assis devant moi, au bar. Vous savez, je n’étais pas nerveux de jouer devant lui. C’était quelqu’un de tellement important pour moi; j’ai voulu lui montrer combien je l’appréciais, et combien il m’avait inspiré. Au micro, je l’ai présenté. Mais ce qui m’a touché le plus, c’était de voir qu’il battait la mesure avec son pied! Oscar m’a dit que j’avais un beat comme Nat King Cole…
*
CONTACT: Giulio Vannini (manager), ratpackmusic@gmail.com, +39 345 790 2481
DISCOGRAPHIE
Leader/Coleader
LP 1983. Coming Out, Concord Jazz 228
LP 1985. Soulful Swinging, Parkwood 110
LP 1985. Live at Baker’s Keyboard Lounge, Parkwood 105
LP 1989. Reunion. With the Murphys, Sophia 003
CD 1995. On the Montreal Scene, Justin Time 85
CD 2002. In Good Hands, Jazzabel
CD 2005. Rockin’ the Spirit: Piano Blues, Boogie & Spirituals, Chesky Records 294 (avec Monty Alexander, Eric Reed, Bob Seeley, Mark Braun)
CD 2013. Nearness, Burner Records 112251 (avec Tine Bruhn)
CD 2014. Live at Smalls, SmallsLive 41
CD 2016. O’Neal is Back, Abeat Records For Jazz 151
Sideman
CD 1978-83. Art Blakey and the Jazz Messengers, The Sesjun Radio Shows (1978, 1980, 1983), Out of the Blue 2010171
CD 1980. Milt Jackson, High Fly (Live at E.J.’s), JLR Records 103.60, 1996
CD 1981. Urbie Green, Just Friends, E.J.’s 609, 2006
CD 1981. Harry Sweets Edison/Eddie Lockjaw Davis, Whispering, E.J.’s 612, 2006
CD 1981. Scott Hamilton, Groovin’ High (Live at E.J.’s), Dino Music 103607
CD 1981. Clark Terry, Ow (Live at E.J.’s), Storyville 1018378
LP 1981. Art Blakey and the Jazz Messengers, Album of the Year, Timeless SJP 155
LP 1982. Art Blakey and the Jazz Messengers, Oh-By the Way, Timeless SJP 165
LP 1983. Art Blakey & All Star Jazz Messengers, Aurex Jazz Festival ’83, Eastworld 80270
CD 1990. Ed Thigpen, Easy Flight, Stunt 19912
CD 2002. Charlie Biddle, In Good Company, Justin Time 090
CD 2006. Scott Hamilton, Sulky Serenade, Jazz Hour 73634
CD 2006. Wycliffe Gordon, Cone’s Coup, Criss Cross Jazz 1278
CD 2006. Harry "Sweets" Edison, But Beautiful, Jazz Hour 7704951
DVD
DVD 2006. Tight, BoJazz Productions
DVD 2006. Ray, Universal Pictures (dans le rôle de Art Tatum)
VIDEOS
Johnny O’Neal & Luke Sellick, «Overjoyed, «Emily», «I Loves You Porgy», «This Is Always», «C Jam Blues», «Cute», Live at Mezzrow, NYC, November 17, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=-ukIdPIsM-Y
Johnny O’Neal (p), Luke Sellick (b)
Johnny O’Neal with Jazz at Lincoln Center Orchestra, «Lush Life: Celebrating Billy Strayhorn», June 10, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=hD_Gu93uHRE
Johnny O’Neal, «Next Spring» (2002)
https://www.youtube.com/watch?v=4l7o0jK6Ukw
Johnny O’Neal (p), Peter Washington (b), Lewis Nash (dm)
Johnny O’Neal Trio, «If I Should Lose You» (1982)
https://www.youtube.com/watch?v=R3ACbR5kSU8
Johnny O’Neal (p), Ray Brown (b), Frank Severino (dm)
Art Blakey and the Jazz Messengers, Live in Montreux, July 23, 1983
https://www.youtube.com/watch?v=PVlXupiuPNc
Art Blakey (dm), Terence Blanchard (tp), Donald Harrison (as), Jean Toussaint (ts), Johnny O’Neal (p), Lonnie Plaxico (b)
Milt Jackson, «Here’s That Rainy Day», Live at E.J.’s, Atlanta, GA (1980)
https://www.youtube.com/watch?v=izzPAGJvTXc
Milt Jackson (vib), Johnny O’Neal (p), Steve Novosel (b), Vinnie Johnson (dm)
Clark Terry, «Georgia On My Mind», Live at E.J.’s, Atlanta, GA (1981)
https://www.youtube.com/watch?v=V5anOryAW2w
Clark Terry (tp), Johnny O’Neal (p), Dewey Sampson (b), James Martin (dm)
Ed Thigpen, «Easy Flight» (1990)
https://www.youtube.com/watch?v=w2-SfJrWbto
Ed Thigpen (dm), Tony Purrone (g), Johnny O’Neal (p), Marlene Rosenberg (b)
| 
